CES ÉTRANGES COUTUMES QU’ON A (PRESQUE) OUBLIÉES
- Par laptitemaisonmaltat
- Le 22/12/2020
Nous revoilà confinés. A l’approche de l’hiver, ça incite encore plus à la mélancolie, même si le début de l’automne à ressemblé à « l’été de la Saint-Martin ».
Parlons-en, justement, de ce Saint-Martin et de tout ce qui faisait l’univers fantasmagorique de nos aïeux. Liées aux rythmes de l’année religieuse, ces coutumes pourtant n’avaient souvent rien de très « catholique ».
Commençons par la Toussaint.

L’Église a beau répéter que « c’est la fête de tous les saints », pour tout un chacun, elle n’a rien de gai. D’ailleurs, quand on dit « un temps de Toussaint », pluie ou ciel maussade, on l’assimile à la tristesse de la mort. Parce que le lendemain, c’est justement la fête des Morts.
L’Église n'a pu faire que récupérer la croyance celtique du jugement des morts que présidait cette nuit-là le terrible Teutatès, tandis qu'on éteignait tous les feux de la Gaule.
Au XVIIe siècle, les Mâconnais, eux, illuminaient leurs cimetières comme des reposoirs et y défilaient la nuit venue. Longtemps, on continua à sonner le glas toute la nuit tandis que les Bressans ne mettaient pas le nez dehors avant le jour.
Le repas du soir du 1er novembre comportait en Bresse de la bouillie de millet dont chaque grain avalé était censé délivrer une âme du purgatoire. Ailleurs, c'étaient quelques châtaignes (après avoir mangé, riches et pauvres, les "châtaignes de la Toussaint") qu'on laissait sur la table après la veillée, à l'intention des morts.
Les interdits pleuvaient : pas de lessive le jour des Morts, de peur d'y "laver son suaire", pas de travail de la terre ce jour-là, et pas de jeu de cartes la semaine de la Toussaint.
Le grand jour de la Saint-Martin

Pour le monde rural, le 11 novembre n’est pas que la commémoration de la victoire de 14-18. C’est aussi, traditionnellement, le jour du déménagement ; changement de ferme, changement de propriétaire, changement de personnel… et aussi jour du paiement des fermages. Autrefois, c’était l’époque des « louées d’hiver », aussi importantes que les louées de la Saint-Jean, rencontres d’embauche où se jaugeaient patrons et commis.
Et pour fêter ces changements, on faisait bonne chère, avec le vin nouveau et l'"oie de Saint-Martin", inséparable de l'imagerie du charitable soldat romain.
Peut-être ces agapes rappellent-elles les « Vinalia », fêtes païennes en l'honneur de Bacchus, dont on peut imaginer l'ambiance orgiaque, peu à peu christianisées et assagies.
Mais comme c'est également l'époque où l'on rentre les pommes de terre, légume omniprésent de la nourriture bourguignonne et particulièrement morvandelle, on fêtait en Morvan la "Tirée des Treuffes" à la Saint-Martin en faisant des dégustations de galettes... de pommes de terre. Il faut dire que cet étrange tubercule, "découvert" ou plutôt lancé au XVIIIe siècle par Parmentier, était déjà mangé dans la province depuis un siècle, sous les noms exotiques de catrouille, tertofle, tartoufle et, jusqu'à aujourd'hui, de treuffe.
Le temps de l’Avent et des loups-garous

A peine passée la joyeuse Saint-Martin, nous voilà dans le temps de l’Avent. Comme le Carême avant Pâques, le temps de l’Avent était jadis un temps de pénitence et donc, dans l’esprit populaire, un temps de peurs, d’autant plus justifiées que la nuit tombe vite et que les ombres paraissent facilement maléfiques.
Alors, nos aïeux évitaient les loups-garous qui pouvaient les suivre et, dans ce cas, cassaient deux branches de verne et les mettaient en croix sur le chemin pour les chasser. Ils évitaient les abords des étangs et des cimetières pour ne pas y rencontrer les "queulards", ces âmes d'enfants morts sans baptême.
Quant au bétail qui risquait de boiter à cette époque ( !), on conjurait le sort en déposant aux portes d’écurie de la suie ou de la cendre.
Heureusement, il y a la perspective de Noël, annonciateur d’agapes spirituelles ou matérielles (la petite étoile qui brille dans la nuit ou le fumet de la dinde qui fait saliver d’avance, c’est selon…). Il y a aussi les calendriers de l’Avent pour les enfants, affaire de commerce lucrative… mais d’où viennent-ils ? Comme le sapin de Noël illuminé et décoré, ils viennent d’Allemagne. Ils ont succédé, au début du XXe siècle, à ces images pieuses qu’on donnait aux enfants chaque matin vingt-cinq jours avant Noël, et leur commerce a débuté dans les années 1920.
Sources : ouvrages de folklore, témoignages, wikipedia.
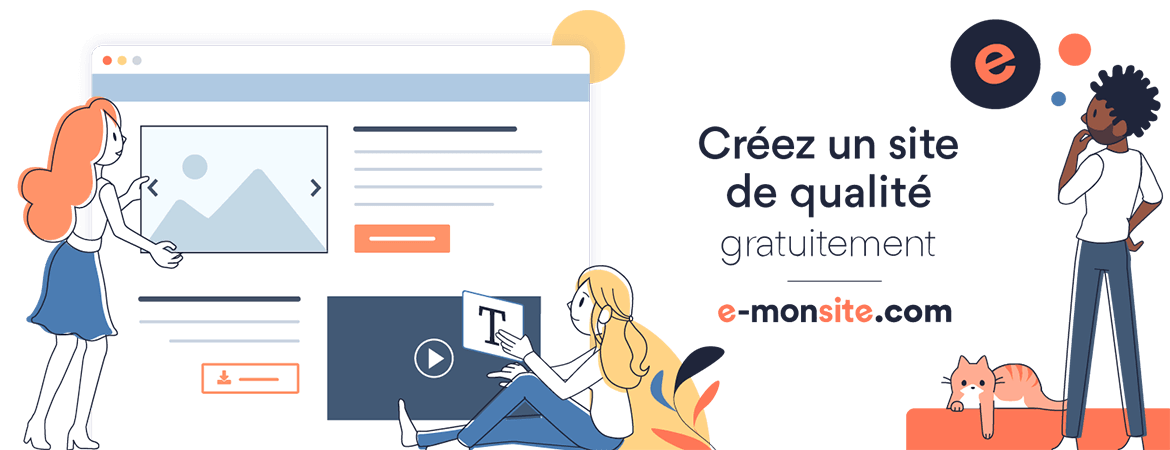




 ème visiteur
ème visiteur










